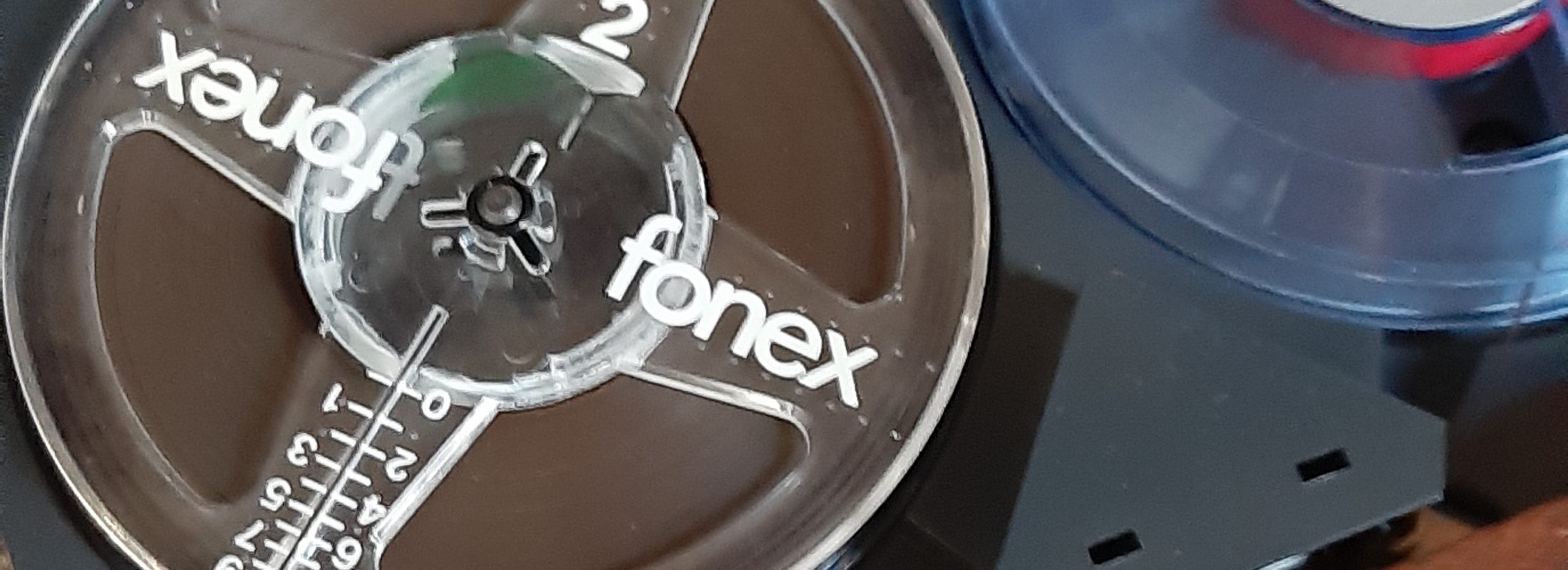
Construire une narration (suivi de projet)
Antoine Richard, Marc-Antoine Granier
« Un documentaire s’écrit trois fois, à l’écriture du projet, au tournage et au montage. »
Transformer la polyphonie du monde en objet sonore suppose d’imaginer un dispositif d’interprétation de la matière enregistrée. Car le réel a peu d’intérêt dans sa saisie brute : il ne prend forme et justesse que dans une réécriture. C’est notamment le travail du montage qui donne à la radio sa dimension narrative. Ses combinaisons multiples jouent un rôle décisif dans la recherche d’une voie singulière. Or, même sur des projets bien cadrés, cette étape de construction implique toujours d’explorer plus d’un chemin (et de savoir en rebrousser parfois pour s’engager dans de nouvelles voies). Parmi les difficultés les plus fréquentes, il arrive que la matière enregistrée déborde le projet ou le dévie de son axe. Comment gérer cet écart ? Comment prendre du recul avec ce que racontent les sons alignés sur les pistes ? Comment, à partir d’un échafaudage provisoire d’hypothèses et de rushes, (ré)interroger ce qui a déclenché le désir initial du documentaire ou de la fiction, pour relancer sa construction ? Ce processus gagne à être partagé. C’est le propos de ce workshop qui vise à dynamiser ce temps de fabrication, en permettant à chacun.e de fortifier ses intuitions d’auteur, de gagner en assurance et en originalité dans ses options de narration.
Jadis, notamment à l’ACR de France Culture (1), cette gestation s’étalait sur un temps long, mais surtout, s’opérait en équipe dans un dialogue entre auteurs et techniciens. Ce dialogue permettait de réfléchir longuement à l’alliance du fond et de la forme. « Il y avait toute la réflexion, toute la maturation de la chose et surtout des sons que l’on glanait au fur et à mesure de la réalisation » se souvient Marie-Ange Garrandeau, « ce qui permettait de travailler de manière presque illimitée ». C’est cette dimension collective et ce temps nécessaire de maturation, que réintroduit cet atelier.
(1) A partir de 1969, l’ACR sera le lieu de l’émergence de nouvelles pratiques, essentiellement documentaires (pour faire court). Au sein de France Culture, c’est une cellule à part qui déroge à l’organisation habituelle du travail et des responsabilités artistiques. Une sorte de programme dans le programme qui s’enregistre en dehors des studios. Dirige ses micros sur la société et sur la rue. Se fabrique de préférence (au moins durant les 10 premières années) collectivement. Son ambition : dépasser l’écrit, échapper à ses facilités (quand bien même une radio d’écrivains a montré sa fécondité) pour explorer l’épaisseur sémantique du sonore.
Objectifs pédagogiques
Prenant appui sur votre parcours professionnel et votre pratique (même récente) du sonore, l’objectif de la formation est de vous accompagner pendant 2 à 3 mois dans le cadre d’un suivi individuel, alternant sessions critiques et étapes de réalisation.
Elle se structure autour de deux axes :
Le premier concerne l’envie, le désir (conscient ou non) de raconter quelque chose par le son et qui doit être stimulé, questionné. Il s’agira de s’appuyer sur les enregistrements de chaque participant pour identifier ce qui est réellement déclencheur, central.
L’autre est d’ordre méthodologique, technique et esthétique. Il s’agit, par des conseils, de lever les obstacles qui peuvent entraver l’avancement de votre projet, très souvent en repensant simplement votre manière de procéder.
A partir des projets de chacun.e, il s’agit de..
1. Tester de nouvelles options d’écriture
2. Accroître sa maîtrise des outils techniques
3. Repenser ses techniques d’enregistrement
4. Apprendre à évaluer son travail et mieux organiser son temps
5. S’écarter du registre discursif pour développer un narratif sonore
6. Devenir inventif dans ses formes de montage
7. Se confronter à l’écoute des autres (stagiaires et intervenant.e.s)
8. Développer sa vision du documentaire
9. Développer son réseau professionnel
Déroulé
Par l’alternance de séances collectives d’écoute de créations radiophoniques et d’entretiens individuels, d’exercices d’écriture et de tournages, il s’agit de passer du projet rêvé à une réalisation en devenir. Ce partage quotidien permettra de faire surgir des idées, des hypothèses, des pistes de travail qui assureront l’ancrage et la poursuite du travail d’élaboration après le stage.
Une petite audiothèque personnelle (liste ou liens de créations) sera proposée aux stagiaires en fonction de chacun de leurs projets.
Les écoutes de créations radiophoniques récentes ou du patrimoine seront suivies d’échanges et de discussions. On y questionnera la place narrative du sonore.
PREMIERE SESSION / 4 JOURS
Collectivement d’abord et ensuite de manière individuelle, nous plongerons dans les travaux de chacun (en pariant sur une fertilisation croisée des réflexions, idées et sensibilités). Chacune, chacun repartira de ces 4 jours avec un regard nouveau sur la structure de son projet (documentaire, fiction ou forme hybride), des propositions méthodologiques et des pistes techniques pour les développer. C’est une étape de décantation et potentiellement de réorientation de chaque projet.
Travail collectif
– Présentation de chaque projet (état d’avancement, difficultés rencontrées, incertitudes)
– Exploration des intentions profondes de chacun
– Evaluation du potentiel narratif du matériel déjà enregistré
– Optimisation des méthodes de dérushage
– Organisation de l’espace de travail de chacune/chacun (logiciel)
– Adoption de nouveaux outils de visualisation de l’œuvre dans son ensemble.
Travail individuel avec le formateur :
– Hiérarchisation de ses rushes
– Evaluation des forces et faiblesses de son projet en terme de structure.
– Affirmation de ses intentions formelles : rythme, espace(s), création sonore ou musicale, cohérence des aspects techniques.
– Essais de montage ou de remontage de séquences
– Articulation d’une première forme narrative
En groupe :
– Analyse collective des montages réalisés
– Ecoute d’œuvres sonores en résonance avec les projets entamés, ou pouvant ouvrir sur de nouvelles pistes d’écriture
ENTRE LES SESSIONS 1 JOURNEE
Une journée au mitan du stage est destinée à des échanges individuels en visio avec le formateur.
DEUXIEME SESSION de 4 JOURS
Nous mesurerons collectivement les évolutions en cours. Puis, par la même alternance de séances collectives et individuelles, nous avancerons dans le travail de montage et de pré-mix avec l’idée que chacun reparte avec une V1 de son projet.
Pendant les temps collectifs :
– Écoute et discussion autour de chaque projet, évaluation des avancées et des alternatives
– Découverte d’œuvres sonores en résonance avec les projets engagés
– Approche des réseaux de diffusion de la création radiophonique (constitution d’un « carnet d’adresse » de diffuseurs potentiels (structures publiques, privées, radio, podcast, festival, prix et concours, presse, etc…)
Travail individuel :
– Ajustements ou réorientation des projets
– Poursuite du travail de montage dans l’idée d’aboutir à un « ours » (version 1).
– Esquisses des premières idées de mixages et pré-mix.
– Rédaction d’un dossier de communication (note d’intention, textes de présentation, etc…) après identification des possibles diffuseurs
– Bilan et perspectives de chaque projet
Fin de stage :
– Bilan collectif et dernières questions
Informations générales
Public
Cette formation est destinée aux auteurs-autrices, réalisateurs-réalisatrices, étudiants-étudiantes en art ou en cinéma ou professionnels de l’audiovisuel porteurs d’un projet de création radiophonique ou de podcast narratif.
Pré-requis
Familiarité avec les outils de prise de son et de montage. Connaissance des bases du montage sur un logiciel dédié (tout type de logiciel professionnel comme Reaper, Logic, Nuendo, Protools etc…).
Etre porteur.se d’un projet précis au stade de l’enregistrement ou du montage.
Modalités
Présentiel + visioconférence, pour combiner l’efficacité des deux situations
Le formateur prend connaissance en amont des attentes et du parcours de chacun.e.
Evaluation
- Pré positionnement en amont de la formation : dossier + entretien
- Évaluation en continue par le formateur/la formatrice
- Évaluation finale avec mise en situation : réalisation d’un projet documentaire
Un entretien individualisé à l’entrée en formation et à l’issue de la formation, permettent de mesurer la progression réalisée par chaque participant au regard de ses objectifs personnels. Une attestation individuelle de fin de formation, rappelant les objectifs visés, est remise à chacun. Un questionnaire d’évaluation qualitative du stage est soumis à chaque participant après la formation et analysé par l’équipe pédagogique. Ces retours permettent d’optimiser le dispositif du stage.
Admission en formation
Chaque candidat reçoit en amont de la formation un questionnaire d’auto-évaluation dans lequel il retrace son parcours et formule ses besoins. Nous nous assurons ainsi de l’adéquation de vos attentes avec les caractéristiques de la formation. Ce questionnaire d’autoévaluation est à solliciter et à retourner par mail (info@phonurgia.org) au minimum un mois avant le début de la formation.
Critères d’admission
– Pertinence du média sonore au regard du projet décrit par les candidats
– Entretien préalable avec l’organisme de formation
Moyens pédagogiques
Travail individuel et collectif (avec possibilité d’emprunter du matériel de prise de son pour aller plus loin dans la quête du matériau sonore)
Un studio doté d’une bibliothèque sonore et d’une phonothèque de référence.
L’encadrement est assuré par des professionnel·les en activités, engagés en faveur du documentaire de création.
Moyens techniques
Nous mettons à disposition du matériel de prise de son, montage et mixage. Parmi lesquels : stations de montage MacBookPro et PC équipées du logiciel Reaper. Surfaces de contrôle Icon Plateforme M. Ecoutes monitoring : Cabasse Goelette, Yamaha HS8 MP ou Génélec 8040. Enregistreurs : Zoom H5 et Sounddevice MixPre 3. Casques : Beyerdynamic DT 770 Pro. Microphones : Beyer 88, Rode NT3, NT4, NT5, Shure SM58, AudioTechnica AT 825, AT 40415, AT 8022, Sennheiser MD 21. Schoeps CCM41 et CCM8. Perches, bonnettes, Rycote. Nous vous recommandons néanmoins de vous munir de vos propres équipements (casque, micros, enregistreur, ordinateur) si vous en possédez. Vous conserverez ainsi vos repères personnels, et pourrez en approfondir la maîtrise.
Intervenants


Il est compositeur et réalisateur radio. Fabrique des documentaires où se croisent récits poétiques et création sonore. Sa formation vient à la fois du sonore électronique expérimental et du spectacle vivant (Cie KompleXKapharnanüM), comme de travaux radiophoniques en collectif (co-fondateur de l’émission MégaCombi sur Radio Canut à Lyon). La création radiophonique est pour lui une affaire de curiosité, de mélanges des genres et d’influences multiples. Il a produit des essais radios pour France Culture (Ateliers de la Nuit, Création on air, L’Expérience) et pour la RTBF, la RTS, Radio Campus. Ses pièces Entre les mères, Total désir, Ville Souterraine, 23 Nuits.., ont été diffusées dans plusieurs festivals et sur la plateforme Tënk. En 2019, Ville souterraine reçoit le prix Phonurgia Nova BnF Archives de la Parole. Il chemine dans le sensible de la ville où il aime à se perdre. marcangranit.com
Retour d'expériences
Informations
Stage 1_2ème partie : Arles Toutes les sessions :
Stage 2_1ère partie : Arles Toutes les sessions :
7 Oct 10 Oct 2024 Stage 2_2ème partie : Paris Toutes les sessions :
9 Déc 12 Déc 2024
Durée : 2 x 4 jours + visio 1 heure (57 heures)
Effectif : 7 participants maximum
Etudiant : 600 euros
Individuel : 900 euros
Formation continue : 2850 euros
Financement OPCO (AFDAS,…) ou Pôle Emploi possible
Plus de renseignements sur ce stage
Par téléphone au 06 09 64 65 39
Par email : info@phonurgia.fr